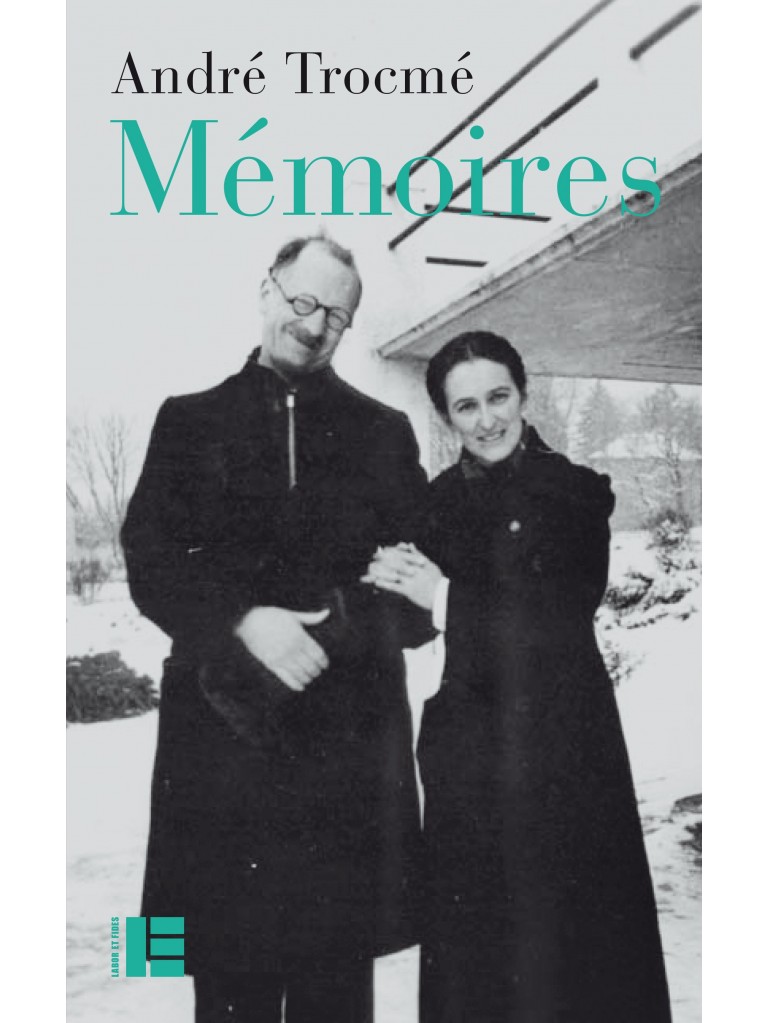Présentation de Ramazan Özgü lors de la journée de réflexion « Quel pacifisme aujourd’hui? », le 19. Novembre 2022. Traduction: Rose-Marie Gyger
Par polarisation au sens politique et social, on entend le processus de différenciation et de fragmentation de la société. Dans ce contexte, deux formes de polarisation retiennent particulièrement l’attention : la polarisation thématique et la polarisation de groupe. Dans ma contribution, j’essaierai d’aborder ces deux points en procédant de manière illustrative :
Tout d’abord avec un décès survenu en France, qui a fait parler de lui pendant la pandémie. En automne 2020, deux hommes montent dans le bus que conduit Philippe Monguillot. Tous deux se présentent de manière menaçante et un peu irritable. Ils n’ont en outre pas de billet. Une brève discussion s’engage, des insultes fusent, mais Philippe Monguillot reste malgré tout calme et leur montre comment acheter un billet à l’automate. Apparemment, la situation se calme après qu’ils ont quitté le bus.
Quatre heures plus tard, les deux hommes montent à nouveau dans le bus, accompagnés cette fois d’un autre ami qui possède un chien de combat. Ils prennent place à l’arrière, s’enivrent, insultent et provoquent le chauffeur. Lorsqu’un quatrième collègue du trio monte à bord à la station Balichon, la situation dégénère. Philippe Monguillot descend, se rend à l’arrière et fait remarquer aux hommes qu’ils doivent descendre car sans masque et sans billet. Une rixe s’ensuit, qui se termine par la mort du chauffeur de bus. Hormis le manque d’égards, le mépris de la vie et le plaisir de la violence, aucun motif de crime n’est identifiable à ce moment-là. Lors d’une conférence de presse, le procureur Marc Mariée a expliqué le 7 juillet que le chauffeur avait été insulté et agressé alors qu’il voulait contrôler les billets et rappeler l’obligation de porter un masque. Comme pour de nombreux autres crimes, les politiques et les médias tentent de tirer profit de cet acte. Tout le monde lit dans la tragédie ce qui l’arrange. Le Rassemblement national attribue la mort de Philippe Monguillot uniquement à l’immigration, certains diffusent de faux noms de coupables arabes et mettent en ligne la photo d’un homme d’origine maghrébine qui n’avait aucun lien avec l’affaire. De nombreux médias se focalisent sur les mots clés « masque » et « obligation de porter un masque ». Ces mots qui polarisent presque partout dans le monde cet été-là et qui garantissent un taux d’audience élevé. Une dispute mortelle « autour des masques » et des « règles sur les masques » aurait eu lieu en France : « Parce qu’il demandait à ses passagers de porter des masques, ils se sont battus contre lui », affirme le « Spiegel ». « Une dispute sur l’obligation de porter un masque se termine par une mort cérébrale », titre le « Deutschlandfunk ». L’absence de billets n’est mentionnée qu’en passant dans la plupart des reportages, et on n’apprend presque rien sur les insultes proférées auparavant par les agresseurs, qualifiés de « réfractaires au port du masque » ou d' »opposants au port du masque ».
Les divergences d’opinion sont importantes pour une démocratie vivante, mais lorsque deux camps s’opposent de manière irréconciliable, il devient difficile de mener des débats et de trouver des compromis. La polarisation thématique était omniprésente pendant la pandémie, ce qui a également fortement influencé la perception des médias. Par exemple, de nombreuses personnes se sont laissées guider par les stéréotypes et les préjugés courants qu’elles ont enregistrés dans leur tête lorsqu’elles se sont interrogées sur l’authenticité des nouvelles mentionnées, ce qui a accéléré et polarisé les divisions au sein de la société.
Les préjugés, les stéréotypes, qui sont omniprésents – et qui peuvent éventuellement sembler inoffensifs – peuvent également avoir des conséquences dévastatrices dans certaines situations. Un exemple serait le préjugé clairement antisémite selon lequel les juifs sont riches. Pour beaucoup, il peut s’agir d’un préjugé « positif » entre guillemets, mais il renforce la prétendue judaïté mondiale, selon laquelle les Juifs dirigeraient le monde. En d’autres termes : Celui qui croit au stéréotype « les juifs sont riches » finira aussi par trouver des faveurs dans le judaïsme mondial. Surtout en temps de crise.
Pendant la pandémie, les récits de conspiration antijuifs ont par exemple gagné en popularité, ce qui est confirmé par la Fédération suisse des communautés israélites. Ainsi, début 2021, le parti National Orientierter Schweiz (PNOS), dissous entre-temps, a publié dans le magazine de son parti les Protocoles des Sages de Sion, un document judéophobe dont la fausseté a été démontrée il y a des décennies. De plus, la devise d’un participant à une manifestation anti-Corona à Zurich était que les Rothschild étaient derrière les mesures Covid. Notre expérience de l’histoire montre clairement où cela peut mener en fin de compte.
C’est à juste titre que le chercheur en génocide Gregory Stanton qualifie la polarisation de partie intégrante d’un génocide systématique. Selon Stanton, elle est considérée comme la cinquième phase du génocide. A ce stade, la propagande polarisante est diffusée par des groupes haineux. La ségrégation devient structurelle, comme par exemple les lois et les restrictions qui interdisent les mariages mixtes ou rendent l’interaction sociale plus difficile. Pour continuer à alimenter la polarisation, les opinions modérées qui pourraient faire office de bâtisseurs de ponts sont intimidées, arrêtées ou assassinées. Selon Stanton, entre les étapes de polarisation et d’extermination, il ne reste plus que la question de l’organisation. Stanton choisit délibérément le terme « extermination », car les criminels de génocide ne croient pas que leurs victimes sont des êtres humains à part entière. Car avant la polarisation radicale commence la négation de l’humanité de l’autre groupe. Les membres de ce groupe sont assimilés à des animaux, des insectes ou des maladies. La déshumanisation surmonte l’inhibition humaine normale face au meurtre. Au cours de cette étape, le groupe victime est rabaissé par une propagande haineuse dans les médias. Maintenant, que pourrait-on faire à ce stade pour préserver la paix : Pour lutter contre la déshumanisation, il ne faut pas confondre l’incitation au génocide avec la liberté d’expression et la sanctionner pénalement en conséquence. Les multiplicateurs locaux et internationaux devraient condamner les discours de haine et les déclarer culturellement inacceptables. Les leaders qui appellent au génocide devraient être interdits d’entrée sur le territoire international et leurs comptes bancaires à l’étranger devraient être gelés.
J’aimerais illustrer l’influence que la déshumanisation peut avoir sur la différenciation sociale par un exemple tiré de la Turquie. Après le scandale de corruption de 2013, Erdogan a fomenté une image d’ennemi contre les personnes qui sympathisaient avec le mouvement Hizmet. Dans ses apparitions publiques, il a qualifié ces derniers : Attention alarme de déclenchement :
« Virus, tumeur, sangsue, traître, réseau traître, bande, ensorcelé, nous entrerons dans leurs cavernes, puant, paresseux, désespéré, je doute de leur foi, menteur, vacuité, pions, suceurs de sang, mangeurs de sang, hérétiques, ils fondent une religion parallèle, esclaves d’Israël, agents de la CIA, vampires, etc. »
Dans les médias dirigés par l’Etat, les sympathisants du Hizmet ne sont plus désignés que par ces termes déshumanisants. Conséquence : l’image de l’ennemi s’est tellement renforcée dans l’esprit des gens que la torture, les viols, les pogroms et les arrestations arbitraires de sympathisants du Hizmet ont été considérés comme légitimes.
Un autre exemple a été observé récemment en Iran. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il est nécessaire de faire un peu d’histoire :
Le Shah Reza Pahlevi avait déjà retiré aux Iraniennes la liberté de pouvoir décider elles-mêmes de leur foulard. Il voulait moderniser son empire sur le modèle turc. Le vêtement islamique était considéré comme un symbole contraire à la modernisation. Le shah autoritaire a interdit le foulard en 1936. Pour de nombreux Iraniens, c’était une attaque contre leurs valeurs. Lorsque le Shah a abdiqué en 1941, une partie des Iraniennes ont à nouveau ostensiblement couvert leurs cheveux. Le foulard était aussi un symbole de résistance. Son successeur a certes continué à suivre un cours de modernisation occidentale, mais l’interdiction du foulard a disparu. La société iranienne commença toutefois à se diviser : Une classe supérieure s’orientait vers l’Europe et vivait dans l’aisance, tandis que la vie restait dure pour une large population. Le foulard est ainsi devenu un symbole de statut social. Avec prudence, on pourrait exprimer ceci : Le prolétariat porte le foulard.
Les partisans de la révolution islamique de 1979 appartenaient à toutes les couches de la société. Les femmes qui ont participé de manière décisive au renversement du régime en avaient assez du régime brutal du Shah, de la vie dans la pauvreté et de l’influence de l’étranger. Les Iraniennes étaient unies par leur rejet du régime du Shah, mais leurs idées sur la vie après le régime ne pouvaient guère être plus différentes. Cela s’est manifesté de manière particulièrement claire avec le foulard. Pour les conservateurs, le hijab était un symbole de la révolution islamique. Il a permis à de nombreuses Iraniennes issues de milieux traditionnels de participer davantage à la vie sociale et de se former. Pour beaucoup d’autres, ce morceau de tissu est devenu un symbole d’oppression. Elles se réjouissaient de célébrer la journée internationale de la femme le 8 mars 1979, mais au lieu de cela, elles ont entendu Khomeiny dire dans un discours que les femmes devaient désormais porter un foulard.
Les protestations furent si importantes que le nouveau régime renonça temporairement à insister sur l’obligation de porter le hijab. Mais dès juillet 1980, Khomeiny a ordonné aux ministères de veiller à ce que les femmes s’habillent de manière islamique. Progressivement, le gouvernement a interdit l’accès à la société aux Iraniennes non voilées, les protestations contre cette décision ont été réprimées. A partir de l’été 1981, le port du voile dans la rue a été imposé avec l’aide des gardiens de la révolution et de la police des mœurs. Depuis 1983, le port du hijab est obligatoire pour toutes les femmes et les filles à partir de neuf ans.
Aujourd’hui encore, les Iraniennes luttent contre leur oppression et pour pouvoir décider librement de la manière dont elles s’habillent. La question de savoir si elles peuvent montrer leurs cheveux en public est pour beaucoup au cœur de cette lutte. Le hijab est pour elles le symbole de toutes les injustices qu’elles subissent depuis des décennies.
Depuis la mi-septembre, des milliers d’Iraniens sont à nouveau descendus dans la rue – il s’agit des manifestations les plus violentes depuis plusieurs années. Elles ont été déclenchées par Mahsa Amini, 22 ans, qui a été si gravement maltraitée par la police religieuse et des mœurs de Téhéran qu’elle est morte trois jours plus tard à l’hôpital. Son crime : Elle n’était pas habillée correctement selon les règles de l’islam.
On peut ici établir un parallèle avec la Turquie. Lors de l’arrivée au pouvoir d’Erdogan, l’interdiction du foulard dans les universités a joué un rôle important. Dans les années 90, les femmes n’avaient pas le droit d’entrer dans les institutions de droit public et d’étudier en portant le foulard. Les étudiantes portant le foulard devaient quitter les amphithéâtres. Aujourd’hui, de nombreuses femmes marquées par la religion ont peur d’un changement de gouvernement précisément pour cette raison. Dans de nombreuses apparitions publiques, Erdogan continue d’attiser cette peur. En utilisant l’expression « ma sœur qui porte le foulard », il suggère qu’en tant que frère aîné, il veillera à la protéger. Il s’agit là d’une pure incitation à la peur, car l’opposition s’est engagée depuis longtemps pour la réconciliation avec les victimes de l’époque.
L’obligation et l’interdiction du foulard partent de considérations patriarcales selon lesquelles les hommes doivent protéger les femmes. Même contre leur volonté. Le débat sur le foulard polarise la société, comme nous le voyons aujourd’hui. Chaque jour, des personnes sont brutalement assassinées parce qu’elles réclament la liberté. Je voudrais profiter de l’occasion pour exprimer ma solidarité avec toutes ces courageuses manifestantes : femme, vie, liberté.
Eh bien, qu’est-ce qui aide à lutter contre la polarisation ? Le philosophe américain Jay Garfield écrit ceci dans son essai « La polarisation détruit notre démocratie » : « Sans un espace public stable pour la discussion, nous ne pouvons pas résoudre de problèmes dans la démocratie ». Son appel au respect et au dialogue sincère avec ceux qui ne pensent pas comme lui peut également nous être utile. Le dialogue, fondé sur le respect, crée une base commune pour surmonter les polarisations. Il faut ici des personnes modérées qui ne se lassent pas de construire des ponts, quelle que soit la situation.
L’absence de voix modérées dans la fonction de bâtisseurs de ponts ou, pire encore, le « silence du centre », comme le livre d’Ulrike Ackermann a été intitulé, pousse la polarisation à son paroxysme. L’histoire de l’humanité montre que cela peut avoir des conséquences désastreuses.