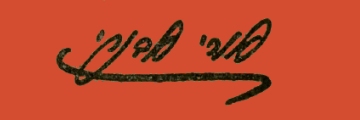Par Uri Avnery
Après avoir commenté la plupart des épisodes de la série télévisée ‟Les Capitaines” de Raviv Drucker sur les Premiers ministres des débuts, il me faut revenir sur l’épisode dont je n’ai pas encore parlé : Yitzhak Rabin.
Permettez-moi de le dire d’entrée : j’aimais bien l’homme.
Il était un homme selon mon cœur : honnête, cohérent, franc, direct.
Pas d’inepties, pas de bavardages. Vous entriez dans la pièce, il vous versait un whisky sec (il semblait détester l’eau), vous faisait asseoir, et posait une question qui vous obligeait à aller droit au but.
Comme c’est rafraîchissant comparé à d’autres politiciens. Mais Rabin n’était pas vraiment un politique. C’était un militaire dans l’âme. Il fut aussi l’homme qui aurait pu changer l’histoire d’Israël.
Le fait marquant de sa vie fût, à l’âge de 70 ans, d’avoir complètement changé sa façon de voir.
Il n’est pas né homme de paix. Loin de là.
C’était un sioniste aussi orthodoxe que possible. Il combattit dans les guerres d’Israël, justifiées ou pas, sans poser de questions. Certaines de ses actions furent brutales, certaines très brutales. Pendant la première intifada dans la bande de Gaza, il a dit ‟brisez-leur les os” et des soldats le prirent à la lettre.
Alors, comment cet homme en vint-il à reconnaître le peuple palestinien (dont l’identité même était déniée), à négocier avec la direction ‟terroriste” palestinienne et à signer l’accord d’Oslo ?
J’ai la chance d’être, peut-être, la seule personne au monde à avoir entendu de la bouche des deux principaux protagonistes du drame d’Oslo comment ils en étaient arrivés à ce tournant dans leur vie – et dans la vie de leurs deux nations. Ils me l’ont dit eux-mêmes (en des occasions différentes bien sûr).
Le récit de Rabin était à peu près celui-ci : après la guerre de 1967, je croyais à l’option jordanienne, ainsi que la plupart d’entre nous. Comme personne ne croyait à l’époque qu’on nous laisserait garder les territoires occupés, nous voulions les rendre au roi Hussein, à condition qu’il nous laisse garder Jérusalem Est.
Un jour, le roi annonça qu’il se lavait les mains de la Cisjordanie. Alors l’option est morte. L’un de nos experts défendit l’idée de mettre en place des ‟Organisations de villages” en Cisjordanie pour négocier avec elles. Ces organisations disparurent très vite.
En 1993, une conférence de paix israélo-arabe se réunit à Madrid. Comme Israël ne reconnaissait pas les Palestiniens, les représentants palestiniens des territoires occupés furent inclus dans la délégation jordanienne. Mais quand on en vint à discuter de la question palestinienne, les Jordaniens se levèrent et quittèrent la pièce, laissant les Israéliens face aux Palestiniens.
Tous les soirs les Palestiniens disaient aux Israéliens : maintenant nous devons appeler Tunis pour avoir des instructions de Yasser Arafat. C’était ridicule. C’est pourquoi, lorsque je suis redevenu Premier ministre, j’ai décidé qu’il était préférable de parler avec Arafat lui-même.
(Le récit d’Arafat était semblable : nous nous sommes engagés dans la lutte armée. Elle n’a pas permis de vaincre Israël. Puis nous avons amené les armées arabes à attaquer. Au début de la Guerre d’Octobre, les Arabes ont de fait remporté une brillante victoire, mais ils ont néanmoins perdu la guerre. J’ai réalisé que nous nous ne pourrions pas battre Israël, et donc décidé de faire la paix avec Israël.)
Dans son chapitre sur Rabin, Drucker donne une image qui – je crois – n’est pas exacte.
Selon lui, Rabin était une personne faible qui a presque dû se faire traîner à Oslo par Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères. Comme témoin oculaire, je dois témoigner que cela est totalement faux.
J’ai rencontré Rabin pour la première fois à la piscine. Je bavardais avec Ezer Weismann, le commandant de l’armée de l’air, qui avait irrité Ben-Gourion par ses blagues grossières. Rabin arriva, comme nous en tenue de bain. Il m’ignora et s’adressa directement à Ezer : ‟N’avez-vous pas déjà assez d’ennuis sans parler en public avec Uri Avnery ?”
La fois suivante je l’ai rencontré en 1969, quand il était ambassadeur à Washington. Nous eûmes une longue conversation, au cours de laquelle j’ai défendu l’idée que la seule façon de préserver l’avenir d’Israël était de faire la paix avec le peuple palestinien sous l’autorité d’Arafat. Rabin fut totalement opposé à cette idée.
Après quoi, nous nous sommes souvent rencontrés. Une de mes amies, la sculptrice Ilana Goor, était obsédée par l’idée de nous amener à parler ensemble. Elle organisait donc de fréquentes soirées à son atelier de Jaffa, dont le réel objectif était de nous mettre en contact. Nous nous retrouvions généralement au bar, et quand tous les autres étaient partis, nous nous asseyions pour parler, souvent avec Ariel Sharon. De quoi ? De la question palestinienne évidemment.
Lorsque j’ai commencé mes entretiens secrets avec les délégués d’Arafat, d’abord avec Said Hamami et plus tard avec Issam Sartaoui, j’allai voir Rabin au bureau du Premier ministre pour lui en parler. La réponse de Rabin était typique : ‟Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je n’interdis pas vos rencontres. Et si vous entendez quelque chose dont vous pensez que le Premier ministre d’Israël doive être informé, ma porte est ouverte.”
Ensuite je lui apportai plusieurs messages d’Arafat, qu’il ignora en totalité. Ils concernaient des affaires mineures, mais Rabin disait : ‟Si nous nous engageons dans cette voie, cela conduira inévitablement à un État palestinien, et je n’en veux pas.”
Arafat voulait évidemment entrer en relation avec Rabin. Je pense que c’était la raison principale pour laquelle il m’avait reçu la première fois dans Beyrouth Ouest assiégée. (Je fus le premier Israélien qu’il ait rencontré.)
J’aimerais pouvoir dire qu’honnêtement je crois avoir été celui qui persuada Rabin de changer complètement de point de vue et de passer un accord avec les Palestiniens, mais je ne le crois pas. Rabin a été convaincu par Rabin, par sa propre logique.
L’erreur historique de Rabin fût, après le succès de la percée d’Oslo, de ne pas s’être précipité pour faire la paix. Il était trop lent et prudent. Je l’ai souvent comparé à un général qui a réalisé une percée dans les lignes ennemies et qui, au lieu de lancer toutes ses forces dans la brèche, hésite et s’arrête. Cela lui a coûté la vie.
C’était une faute récurrente. À la veille de la Guerre des Six Jours, alors qu’il était chef d’état-major, l’attente prolongée – ou son tabagisme compulsif – lui causa un moment de dépression. Il fût immobilisé pendant 24 heures, au plus fort de la tension, et pendant ce temps son adjoint, Ezer Weismann, prit le commandement.
Cela n’empêcha pas Rabin de remporter une victoire historique dans la guerre, sous le commandement du meilleur état-major qu’ait jamais eu l’armée. Il avait été patiemment réuni par Rabin en cas de besoin.
Des années plus tard, quand Rabin fût choisi comme Premier ministre, Ezer avertit publiquement les gens que Rabin n’était pas à la hauteur de la situation. Dans une scène mémorable, Ariel Sharon s’enferma dans une cabine téléphonique publique avec une pile de jetons devant lui pour téléphoner à chaque rédacteur en chef du pays pour l’assurer que Rabin était à la hauteur de la fonction.
Je pense qu’à sa manière laborieuse, Rabin aurait fini par faire la paix avec le peuple palestinien et aurait aidé à créer un État palestinien. Son antipathie initiale pour Arafat avait cédé la place à un respect mutuel. Arafat lui rendit secrètement visite chez lui.
Le principal sujet du film de Drucker était l’inimitié proverbiale entre Rabin et Peres. Ils se détestaient l’un l’autre, mais ne pouvaient pas se débarrasser l’un de l’autre. Je les ai comparés à des frères siamois qui se haïssaient l’un l’autre.
Cela commença dès l’origine. Rabin abandonna ses études supérieures (en agriculture) pour rejoindre le Palmach, les équipes de terrain de notre armée clandestine. Lorsqu’éclata la guerre de 1948, il assura un commandement sur le terrain.
Peres ne rejoignit pas l’armée du tout. Ben-Gourion l’envoya à l’étranger acheter des armes. C’était certainement une tâche importante, mais elle aurait pu être assurée par quelqu’un de 60 ans. Peres avait 24 ans – deux semaines de plus que moi !
Depuis lors, toute ma génération l’a détesté. Cette honte ne le quitta jamais. Ce fût l’une des raisons pour lesquelles Peres ne remporta jamais une élection de sa vie. Mais c’était un génie de l’intrigue. Rabin, qui avait la langue acérée, le qualifia d’‟infatigable intrigant”.
À la fin, la formidable pomme de discorde fût l’initiative d’Oslo. Peres, en tant que ministre des Affaires étrangères en revendiqua le crédit.
Un jour j’ai eu une expérience curieuse. J’ai reçu un appel me disant que Peres voulait me voir. Etant donné que nous étions des ennemis jurés, c’était étrange. À mon arrivée, Peres me fit une conférence soutenue d’une heure sur les raisons pour lesquelles il était important de faire la paix avec les Palestiniens. Comme c’était l’objet essentiel de ma vie depuis des décennies, alors qu’il s’y était toujours opposé de façon catégorique, c’était plutôt surréaliste. J’ai écouté en me demandant ce que tout cela signifiait.
Peu de temps après, lorsque les accords d’Oslo sont devenus publics, j’ai compris la scène : elle faisait partie de l’action de Peres pour en revendiquer le crédit.
Mais ce fût Rabin, Premier ministre, qui prit la décision et en assuma la responsabilité. C’est à cause de cela qu’il fût assassiné.
La scène finale : l’assassin se tenait au pied des marches, le pistolet à la main, attendant que Rabin descende. Mais c’est Peres qui descendit le premier.
Le meurtrier le laissa passer sain et sauf – l’injure suprême.
Uri Avnery
Article écrit en hébreu et en anglais, publié sur le site de Gush Shalom le 16 juin 2018 – Traduit de l’anglais « The Siamese Twins » pour Conflue. Merci à iremmo.org pour son amicale permission.